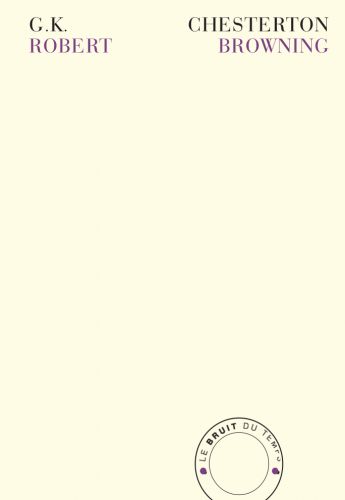L'Anneau et le Livre
Robert Browning
Édition bilingue
Traduction de l’anglais
et étude documentaire
par Georges Connes
Préface de Marc Porée
Relié sous jaquette
Format : 135 x 205 mm
1424 pages
ISBN : 978-2-35873-001-3
Mise en vente : 17 mars 2009
Par une belle journée de juin 1860, à Florence, où il réside depuis plus de dix ans, Robert Browning achète à un bouquiniste de la place San Lorenzo un «vieux livre jaune» qui réunit les documents relatifs à un procès pour meurtre qui se tint à Rome en 1698 et devait lui inspirer les 21000 vers de son long poème narratif, The Ring and the Book.
Pourquoi Robert Browning se passionne-t-il immédiatement pour l’affaire Franceschini ? Est-ce parce que l’histoire de la fuite du beau prêtre Caponsacchi et de la jeune Pompilia, qui tentent d’échapper au terrible Guido Franceschini, fait écho à sa propre hardiesse, lorsqu’il enleva Elizabeth Barrett pour la sauver des griffes de son père, et l’épouser en secret en 1846 ? Sans doute, mais il y a plus : l’histoire grotesque de ce triple meurtre est une formidable démonstration des thèmes qui lui sont chers.
Reprenant la matière du « Vieux Livre Jaune », Browning décide de raconter l’histoire de Guido et Pompilia du point de vue des différents protagonistes de l’affaire, en douze monologues dramatiques, un genre dont il est le maître incontesté.
Dans le premier, « L’Anneau et le Livre», le poète expose une première fois l’affaire, mais aussi son propre projet et sa méthode. Suivent dix monologues dans lesquels on entend successivement les voix du peuple de Rome, partagé pour moitié entre les partisans de l’assassin et ses accusateurs ; la noblesse romaine et ses dignitaires de haut rang ; le comte Guido Franceschini, mari cruel et jaloux, qui a assassiné sa jeune femme Pompilia et ses beaux-parents, Violante et Pietro Comparini ; le jeune et beau prêtre Giuseppe Caponsacchi qui a tenté en vain de sauver la pauvre femme ; Pompilia elle-même, qui agonise quatre jours durant après avoir reçu vingt-deux coups de poignard de la main de son mari, et se confesse sur son lit de mort ; les avocats des deux parties, Arcangeli et Bottini, qui s’affrontent à coups de prouesses rhétoriques et multiplient les arguties ; enfin le vieux pape Innocent XII en personne, à qui la défense a fait appel en dernier recours pour tenter de sauver la tête de l’assassin et de ses quatre complices. La voix du poète résonne à nouveau dans le douzième et dernier livre, « Le Livre et l’Anneau », avant de s’éteindre sur un vibrant hommage à sa femme, la poétesse Elizabeth Barrett Browning.
Le livre, dont les quatre volumes paraissent entre novembre 1868 et février 1869, rencontre un succès considérable auprès du public anglais. La critique parle de chef-d’œuvre du siècle et fait de Browning le digne héritier de Shakespeare.
Comment expliquer un tel enthousiasme ? Il y a évidemment l’affaire criminelle elle-même, riche en péripéties et rebondissements, pour laquelle le lecteur se passionne d’emblée et est tenu en haleine jusqu’à la dernière ligne – les zones d’ombre s’éclairant d’un monologue l’autre jusqu’à lever le voile. Il y a l’ampleur et le souffle de l’expression poétique, l’intensité et l’originalité de la narration de Robert Browning, des vers d’une beauté et d’une force étourdissantes, qui répondent à une maîtrise rythmique et dramatique rarement égalée, le grotesque et l’humour permettant une respiration là où la tension devient insoutenable. On est emporté, dominé par la force narrative et l’imagination du poète. On y retrouve les thèmes qui lui sont chers et qui nous parlent : la nature de la vérité, la justesse de la perception humaine, les dilemmes et contradictions inhérents à la nature humaine, Browning s’interrogeant sur le rôle et la valeur du poète lorsqu’il s’agit de trouver l’expression poétique propre à les refléter pour que les yeux du lecteur puissent voir. Et c’est une peinture acerbe de la société du XVIIe siècle – le statut de la femme, les violences domestiques, les lois sur le mariage et l’héritage, la responsabilité du clergé, l’importance accordée à l’honneur – et des extrémités auxquelles elle conduit.
Georges Connes entreprend la traduction de The Ring and the Book au beau milieu de la guerre, en 1942. Il l’achève un an et demi plus tard, sous l’Occupation, et, passionné par son sujet, rédige une longue Étude documentaire destinée à l’accompagner. Confié à Raymond Queneau juste après la guerre, le manuscrit est perdu à Bruxelles et retrouvé des années plus tard pour être publié en 1959 par les éditions Gallimard. Le livre n’avait jamais été réédité depuis.
À lire également : Henry James, Sur Robert Browning. La Vie privée, nouvelle suivie de deux essais, traduit de l’anglais par Jean Pavans.
En savoir plus sur la traduction :
Chef-d’œuvre dans le chef-d’œuvre : la traduction de Georges Connes, en prose, entreprise en 1942 et achevée sous l’Occupation.
«De quoi s’agissait-il pour moi ? écrit le traducteur, de mettre à la disposition du lecteur français un texte dont je dis une fois encore qu’on le goûte beaucoup mieux en le faisant passer par un gueuloir ; de lui communiquer ces énormes vagues successives de raisonnement, de rhétorique, d’émotivité, de passion, en lesquelles s’épanchent des esprits furieusement intéressés par ce dont il s’agit et ce qu’ils en disent ; tous, même Pompilia, et aussi Browning, ont le souffle d’athlètes inépuisables ; arrêter, donc, l’œil du lecteur à la fin de chaque ligne, comme il est inévitable si on lui présente des vers – il est déjà assez déplorable qu’on soit obligé de lire L’Anneau et le Livre avec les yeux – aurait été une formidable erreur ; c’était avec certitude tuer l’œuvre en français. »
Il n’en sort pas indemne :
«“Ô mon intime pendant ces quatre années, comment iront les choses, lorsque, bientôt, nous allons nous séparer ?” Ainsi parle Browning au Vieux Livre Jaune, lorsque, vers le premier quart du livre XII, il voit son œuvre près de s’achever ; il a évidemment redouté le vide de sa vie et de sa pensée quand il serait, non pas délivré mais privé, de cette tâche passionnante et chérie ; quoiqu’il ait fort bien su remplir l’une et occuper l’autre pendant les vingt ans qu’il a encore vécus. Mon propre corps à corps avec L’Anneau et le Livren’a guère duré qu’un an et demi, entre la première phrase mise sur le papier et le point final au manuscrit provisoire ; mais moi aussi j’ai redouté, après avoir mis ce point final, un vide de l’esprit, un désœuvrement ; j’ai su que, pour autant que je vivrais encore, je ne retrouverais pas l’équivalent de ce que je perdais, pour avoir mené à bonne fin mon entreprise ; et cet achèvement fut une tristesse. »
Georges Connes entreprend la traduction de The Ring and the Book de Robert Browning au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, en 1942. Il l’achève un an et demi plus tard, sous l’Occupation, et, passionné par son sujet, rédige une longue Étude documentaire destinée à l’accompagner. En 1959, Georges Connes revient sur la folle histoire de son manuscrit :
«Le manuscrit, Étude documentaire, texte et notes, était complet, et à peu près dans l’état où il est ici, à la fin de 1943 ; je n’y ai apporté que très peu de retouches de détail. De janvier 1944 à fin mai 1945, j’eus d’autres occupations et d’autres résidences, la prison de Dijon, divers endroits quelque part en France, l’Hôtel de Ville de Dijon à partir du 20 septembre ; je retirai alors mon manuscrit du coffre-fort de la Faculté des Lettres où on l’avait mis par prudence ; ma maison pouvait brûler, et c’était ce que j’avais de plus précieux. Dès les premiers mois de 1945, je trouvais pourtant le temps d’entamer une lutte accablante avec les éditeurs ; tous reculaient épouvantés ; chez bien des “autorités” dont j’invoquais l’appui, je trouvais une ignorance magnifique qui ne me surprenait pas toujours. Heureusement il en était de mieux informées, et des amis plus sûrs ; le 19 mai 1945 je remettais avec plaisir la mairie de Dijon à mon adjoint et ami le chanoine Kir ; dix-huit jours plus tard, le 6 juin, j’étais reçu chez M. Gallimard par M. Raymond Queneau, accompagné de mes amis René Lalou et Léon Lemonnier venus pour m’épauler ; eux savaient de quoi il s’agissait ; mon livre était accepté. Hélas ! deux ans plus tard, en octobre 1947, fatigué d’attendre mon tour comme il était normal, je le portais à Bruxelles, où une firme belge le recevait avec enthousiasme ; sans cette erreur, L’Anneau et le Livre aurait sans doute été publié depuis dix ans. […] la firme belge fit faillite ; mon manuscrit disparut dans le naufrage ; j’étais si dégoûté que je m’en désintéressai pendant des années ; il fut finalement retrouvé pour moi par mon ami Léon Herrmann, le latiniste de Bruxelles. Le voici rentré, après quatorze ans, chez M. Gallimard. »
Le livre n’avait jamais été réédité depuis.
- Le Clavier cannibale de Claro - Quand des cœurs palpitaient fort…
- La Quinzaine Littéraire - n°990 - Le chef-d'œuvre de Robert Browning
- Libération - Cahier « Livres » - Browning en vers et en droit
- Le Magazine Littéraire - n°486 - Le Cahier critique • Domaine étranger
- Télérama - n°3096 - Robert Browning, L'Anneau et le Livre
- Le Matricule des Anges - n°104 - Convulsive alchimie
- La République des Livres - Louons maintenant un nouvel éditeur
- RiLi - n°13 - Browning, poète nécromant
- The Time Literary Supplement - n°5564 - A harmless occupation
- Valeurs Actuelles - Browning : la poésie rendue au monde
- Cahier Critique de Poésie - n°19 - Robert Browning : L'Anneau et le Livre
- La République des Lettres - Robert Browning : L'Anneau et le Livre
- Stalker - Autour de Robert Browning aux éditions Le Bruit du temps
Pour laisser un commentaire, veuillez vous connecter à votre compte client.