Rehauts - « Alaska », par Jacques Lèbre
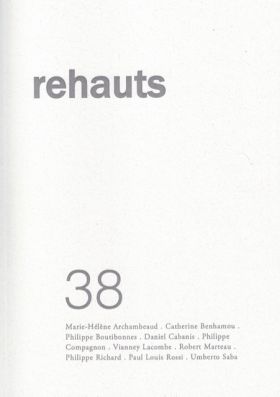
« Alaska »
C’est une poésie éminemment dynamique que celle de Jean-Claude Caër, dynamisme soutenu par l’emploi du je et par celui des verbes : « J’ai décidé de couper le fil »… « Car je vais à Sitka / à Kodiak Island voir les ours bruns / les grizzlis les plus grands d’Alaska. / Je verrai le musée Alutiiq / Sur la première vertèbre des îles aléoutiennes »… « Je suis venu en Alaska / Revoir les mâts héraldiques »… « Je quitte ce matin la vieille maison d’Anchorage ». Parfois le je disparaît pour faire toute la place à l’impression ou à la sensation : « Dans ce matin d’eau et de pluie qui dégouline / Le bruit très puissant des avions qui décollent / a quelque chose de rassurant »… « Regarder un cargo qui s’éloigne / puis disparaît dans le monde gris / au-dessus de la cime des arbres verts / est d’une incroyable mélancolie. » L’impression première, c’est que chez Jean-Claude Caër le voyage tient d’une oscillation qui semble ne jamais devoir trouver son calme plat.
Mais on dirait que le dynamisme n’a d’autre but que de repousser quelque chose à distance, qui cependant fait retour sous la forme d’un désarroi profond, comme si le monde et l’auteur perdaient leurs bords en même temps, et c’est toujours exprimé sans ambages : « L’idée de la mort ne me quitte pas / À quoi bon écrire tout ceci ? / Pourquoi suis-je ici ? »… « La pluie vient de commencer à tomber / Que vais-je faire pendant ces deux jours ? »… « Je me sens étrangement perdu / Je me sens perdu au milieu d’une forêt de totem poles / Alors que ma vie décline / Je me sens perdu en regardant Nicholas Galanin / Descendre de son 4 x 4 / Avec ses trois fillettes blondes comme un tourbillon /… / Je me sens perdu en écoutant le cri d’un corbeau que je ne comprends pas. »
Les voyages de Jean-Claude Caër (il mange, boit et parle avec les autochtones et nous apprend toujours quelque chose sur eux) ne rentrent pas dans la catégorie du tourisme. Ils procèdent d’un décentrement, voulu, cherché, mais qui, une fois sur place, peut s’avérer plutôt déstabilisant, car il semble qu’il y ait toujours un décalage entre le désir et son objet, une sorte de faille qui interdit toute fusion et c’est peut-être faire l’expérience la plus profonde de l’altérité : « Je ne sais pourquoi j’ai fui en Alaska / Parce que finalement je fuis toujours. / Cela se rapporte à mon enfance / Aux livres de mon enfance. / Une biche dans la forêt, les Eskimos, les igloos. » Est-ce consciemment ou inconsciemment une volonté de se fuir soi-même ? Est-ce que la réalité peut jamais correspondre aux livres et aux rêves de l’enfance ? Le décentrement peut aussi donner, par contrecoup, et dans le total désoeuvrement des habitudes (et puis il pleut si souvent : « La pluie tombée du ciel / Qui nous rend toute chose étrange/intime. »), une grande nostalgie des lieux habituels et familiers. Mais le souvenir et la vision de deux photographies qui s’y trouvent viennent tout à coup relancer et justifier le voyage : « Chez moi, à Prat-Néon, dans le salon / Deux photos sont posées l’une près de l’autre / Une de la poétesse russe, Olga Sedakova, /Assise sur les marches de sa datcha /Et une photo d’Arrowhead, la maison d’Herman Melville. / Ce que je suis venu chercher ici à Kodiak était déjà présent à Prat-Néon… / Excitation — incitation à ce voyage. »
Mais pourquoi suis-je parti ?! Cela aussi est précisé : « Ce qui m’intéresse / Ce n’est pas tant le voyage lui-même / Les destinations / Les rencontres / Mais la manière dont il me transforme / La joie (la peur) que j’éprouve à me transformer. / À devenir quelqu’un d’autre que je ne reconnais pas. » Les rencontres, et cela n’est pas anodin, ne sont pas tout à fait sans conséquence, surtout lorsqu’elles sont fugitives : « Tous ces gens qui apparaissent quelques secondes dans notre vie / Tels des drapeaux piqués sur une carte du monde / Puis s’éclipsent définitivement de notre vue / Nous préparent peut-être à notre propre disparition. »
Une fois qu’il est sur place, on dirait que chez Jean-Claude Caër le voyage ne se hausse jamais à la hauteur de la promesse, il y a comme un trou d’air, un flottement : « C’est comme si je flottais au-dessus de moi-même », pouvions-nous lire dans En Route pour Haida Gwaii (Obsidiane). Aussi, soudain nous comprenons : dans le flottement du voyage, les poèmes servent de lest.
Jacques Lèbre
n° 38
