Europe - n°962-963 - Ossip Mandelstam : Le Timbre égyptien
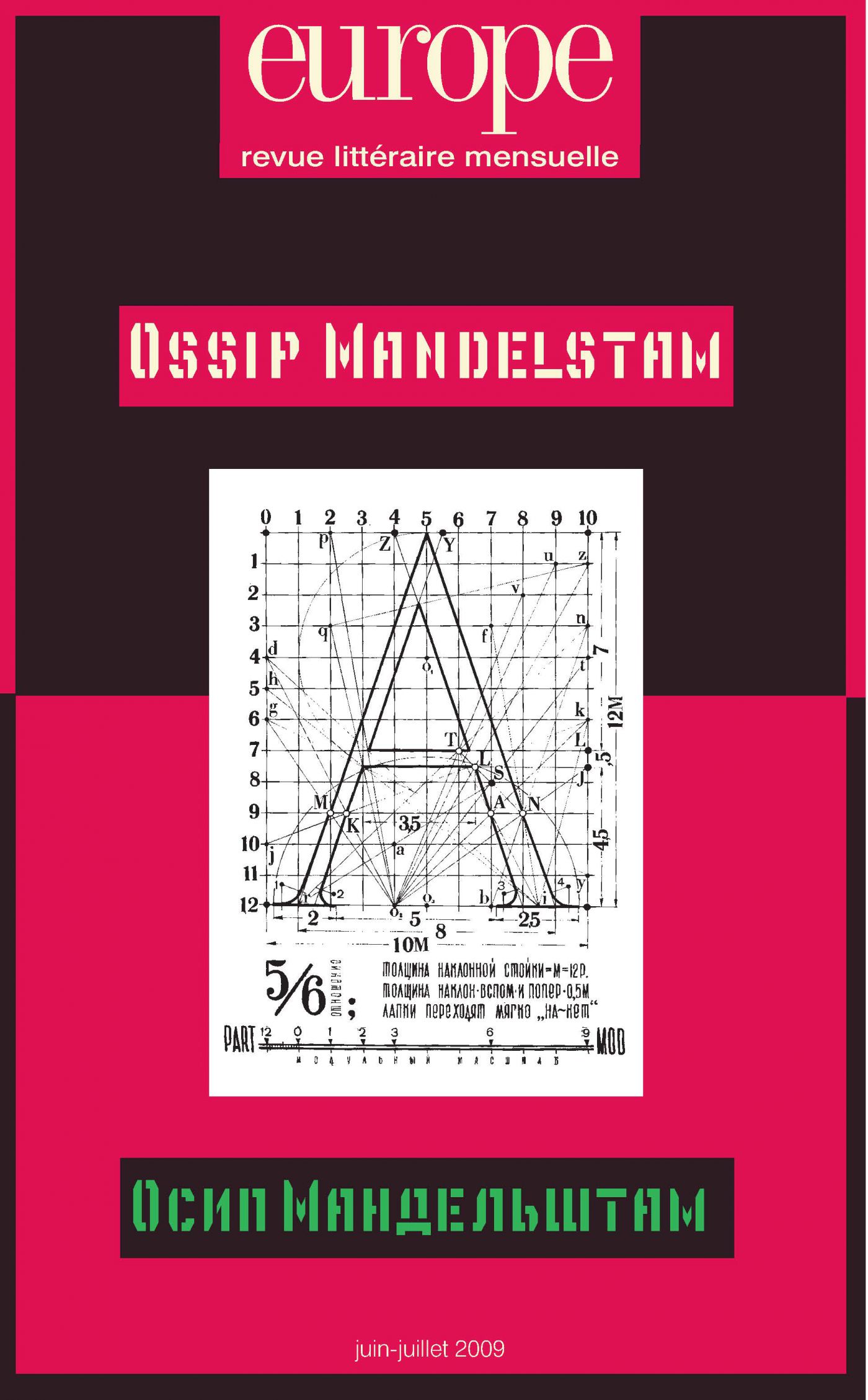
Ossip Mandelstam : Le Timbre égyptien
Les jeunes éditions Le Bruit du temps nous proposent un volume d'une modernité inoxydable, Le Timbre égyptien, seul récit en prose de Mandelstam. Il s'agit de la reprise, avec les légères modifications qui s'imposaient, de la traduction parue en 1930 dans la prestigieuse revue Commerce, deux ans après l'édition originale. Elle est servie à l'époque par Georges Limbour, proche des surréalistes comme de l'univers onirique du poète, et par D.S. Mirsky, fils d'un ministre de l'Intérieur de Nicolas II, qui connaît tous les membres de la génération exceptionnelle de poètes russes que le siècle XX sacrifiera. Émigré à Londres au début des années vingt, Mirsky adhère finalement au Parti communiste et retourne en URSS. Il mourra six mois après Mandelstam dans un camp stalinien, en juin 1939. Ralph Dutli offre une préface inédite et son regard de spécialiste, et l'on trouvera en postface la reproduction d'un chapitre du grand livre de Clarence Brown : The Prose of Mandelstam. En baptisant sa maison d'édition Le Bruit du temps, Antoine Jaccottet place son travail sous le signe mandelstamien. Le Timbre égyptien entretient avec le livre de souvenirs des rapports discrets. Les réminiscences qui affleurent également dans ce récit relèvent d'un triple enjeu : dénoncer la trahison de l'esprit de la révolution, se réconcilier avec « le chaos de la judéité », préserver la ville de tous les arts, Saint-Pétersbourg, des atteintes pourtant victorieuses de la brutalité. Le résultat sera de reconquérir, car elle semble tarie à l'époque, une voix poétique épuisée par l'indifférence commandée des salles de rédaction. Les signes de l'Apocalypse ne manquent pas mais fournissent le carburant d'un paradoxal moteur : « La peur me prend par la main et me conduit. »
Mandelstam choisit habilement la transition entre février et octobre 1917. C'est « l'été Kerensky ». La révolution se cherche, le populisme est en train de se trouver, la confusion décrite permet de pratiquer un hermétisme de combat. Le synopsis tient en peu de mots. Mervis, le tailleur, a volé la queue-de-morue de Parnok (la lui a reprise en fait, car elle n'était pas payée) et l'apporte, avec des chemises, au capitaine Krzyzanowski. Parnok erre fiévreusement dans la ville de Pétersbourg pour récupérer ses précieux vêtements. Il échoue. Tente d'empêcher un lynchage. Échoue encore. L'État s'est « endormi comme une carpe » et reste passif. Le capitaine en galante compagnie à qui il demande de l'aide, le même qui récupérera les chemises et la queue-de-morue, se refuse à intervenir et le confond d'ailleurs avec le coupable. Parnok délire, sort des grandes avenues pour tracer une ligne de fuite vers la nostalgie et la vision intensive, acméiste et futuriste si l'on veut, des objets et des situations. Il semble perdant sur toute la ligne, mais ce personnage gommé par l'Histoire, victime des préjugés antisémites de ses camarades quand il était petit, eux qui le prenaient pour « un timbre égyptien » susceptible d'effacer toutes les taches imaginables, s'il a échoué à empêcher le lynchage, ne fera pas complaisamment disparaître le sang de son récit. Il voit sa ville détruite, il en préservera l'architecture dans son monologue intérieur. Si sa « roture » persiste et l'empêche d'être drogman au ministère des Affaires étrangères alors que les temps soi-disant changent, il sera d'autant mieux l'interprète, dans un regard faussement sarcastique, du « silence moustachu des appartements juifs ». La véritable généalogie de Parnok est littéraire : il est l'héritier du Doublede Dostoïevski (donc du Nez de Gogol) et d'Akaki Akakievitch Bachmatchkine, l'érchétype du fonctionnaire humilié à qui un tailleur dérobe un manteau dans le récit de Gogol. Cette généalogie fait de Parnok un double de l'auteur, même si le narrateur se défend de toute proximité : « Seigneur, faites que je ne sois pas semblable à Parnok. » Tenu pour invisible, il devient un point de vue sinon décisif, du moins décidé. Ce qui était secondaire dans le roman, la description, va devenir central dans le récit et les digressions seront le plus sûr des chemins pour dire le vrai : « Il est terrible de penser que notre vie est un roman, sans intrigue et sans héros, fait de vide et de verre, du chaud balbutiement des seules digressions et du délire de l'influenza pétersbourgeoise. » Cinq ans auparavant, Mandelstam avait théorisé La fin du roman (1922). À partir du moment où, dans les mouvements de masse, les actions des individus sont diluées, le roman s'évanouit, car il est par fonction l'indicateur des résonances de l'époque sur un individu comme de la reconnaissance par l'opinion du rôle des individus. La biographie ne participe plus de la découverte de soi, ni de l'exploration des classes sociales, puisque les trois catégories sont frappées d'obsolescence. Pourtant, ce petit personnage peut encore promener, sous le soleil jaunâtre de Pétersbourg, une vision aussi bien lucide que mémorielle. La ville se découvre dans le dire de cette prose et se conserve du même pas. Parnok joue le rôle de Pétersbourg avant qu'elle sombre définitivement. Pour Ralph Dutli, c'est d'abord la musique qui est en passe d'être déportée : « cette prose se plaint amèrement de la disparition de la musique ». On déménage un piano dès la première page. Le défilé de sourds-muets au chapitre 5 dit bien le degré d'appréciation de la musique par les citoyens. L'évocation de la mort de la cantatrice Angelica Bosio à Saint-Pétersbourg en 1859, dans la fièvre de ses fantasmes d'incendie, parachève l'allégorie. Le froid de l'État suffit à la pneumonie mortelle. Angelica a perdu sa voix mais pas Ossip « Parnok » Mandelstam. Dans son approche mallarméenne du texte, il ne supporte pas que l'écriture ne serve plus qu'à « la petite monnaie » des mots égrillards. Il suffit d'un lynchage pour compromettre la Révolution. Il suffit d'une voix pour ne pas renoncer à celle-ci. « Quelle joie pour le narrateur de passer de la troisième personne à la première ! »
Petit moustique, le dernier des Égyptien tente l'échappée juive du pays autoritaire de Pharaon. Il y parvient. Sa ville refuge est Saint-Pétersbourg et son pont égyptien. Les humbles se feront enterrer avec leurs objets d'élection, ceux du quotidien, et quel meilleur sarcophage qu'une histoire. Mais Pharaon se déplace à Moscou la bouddhique. Ce récit sur 1917 a bien des implications dix ans plus tard. La lenteur de l'État est devenue une invisibilité meurtrière, les mouvements de masse une colère pilotée et les soldats, qui avaient souvent rallié le peuple, les nouveaux instruments de la répression. Le capitaine s'installe au siège de la Loubianka. Il passe au service de la police secrète, la Tcheka. Exit le soleil innocent. Le stalinisme n'a jamais cessé d'être un tsarisme.
L'écriture dans la marge du narratif, définition possible de la poésie, c'est le combat contre la prose « ferroviaire » qui conduit au Select Hotel (quel nom !), cette prose remplie des outils de « l'accrocheur de wagons » pour dévider au kilomètre des paroles qui ne se soucient ni de la beauté, ni du nombre. La prose surréaliste de Mandelstam fournit au contraire des images inoubliables, qui sont autant de refus de la propagande. Les ponts coupent ou ressoudent la ville comme les vertèbres des deux siècles le font du temps. Les livres européens, que le narrateur dit avoir substitués très jeune à la vie, sont des glaçons qui fondent et rapetissent. La pensée reste tranchante comme le patin. Elle est prête à glisser sur l'époque en train de geler. La ville s'écrie (se crie) sur un jeu d'épreuves humides, non un papyrus desséché. Elle respire toujours le caractère vivace de la culture.
À lire cette nouvelle édition française du Timbre égyptien, le désir se ravive : que le Temps fasse le plus de bruit possible.
Jean-Luc Despax
