AOC, Recension par Marcelline Delbecq
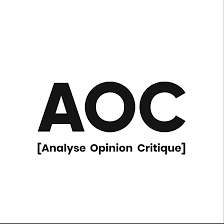
Jamais plus, encore et toujours
Une femme est en résidence à Dresde pour y traduire To the Lighthouse de Virginia Woolf. Un déracinement qui se veut « une interruption du cours de la vie », pourtant Nevermore est conçu comme un éternel recommencement. Ce ressac, qui charrie le fantôme d’une amie disparue et une traduction qui se fait et se défait, entraine dans une lecture que l’on a envie de ne jamais laisser se terminer.
Difficile de demander à un texte de rendre l’intensité procurée par la lecture de Nevermore de Cécile Wajsbrot, paru en février dernier aux éditions Le Bruit du temps. Certains livres, plus que d’autres, apparaissent dans votre vie au moment où vous les attendiez puis deviennent des compagnons silencieux de pensée, de route. Ils cheminent d’autant plus en vous et à vos côtés qu’ils convoquent dans leur sillage d’autres lectures, d’autres expériences qui vous appartiennent.
C’est la couverture de Destruction, paru en 2019 chez le même éditeur, qui avait attiré mon attention dans la vitrine de la librairie Vendredi rue des Martyrs à Paris : un quartier de lune photographié sur fond de ciel entre chien et loup, comme ayant échappé à l’ombre métallique d’une tour – tour Eiffel ou de contrôle, de transmission. Image métaphorique d’un récit aussi mystérieux qu’haletant, dont la portée faisait déjà tellement écho à l’époque que nous venions de traverser et laissait à tel point présager celle qui nous attendait, qu’il est aujourd’hui essentiel de lire ou relire Destruction.
Plus jamais, Oh grand jamais, Jamais plus et pourtant encore et toujours sont peut-être de possibles manières d’aborder Nevermore. Ou transformer « Nevermore » en « Moreover » – over comme l’on met un terme à, en basculant d’une falaise. More pour toujours car le livre m’a entraînée dans une lecture que j’aurais eu envie de ne jamais laisser se terminer, flot passionnant d’une pensée livrée à elle-même comme à ses fantômes. Nevermore est une narration à la fois bouleversante et tenue à distance, plongée dans les méandres d’un esprit auquel seule l’écriture semble offrir un semblant de répit. Il n’est pourtant ici question que d’intranquillité.
Une femme, narratrice dont l’autrice ne nous dit pas si elle est son incarnation et cela n’a pas d’importance, est en résidence à Dresde, ville qu’elle a choisie pour aller y traduire To the Lighthousede Virginia Woolf.
Traduire Woolf dans un endroit où ne sont parlées ni la langue de l’écrivaine britannique ni celle de sa traductrice française offre un déracinement, « une interruption du cours de la vie » qui, on le comprend au fur et à mesure, donne toute sa densité et sa force à l’activité de traduire, mais fera également perdre pied* à la narratrice.
Littéralement plongée dans un travail de fourmi voué à un éternel recommencement – chaque mot de chaque phrase à traduire posant une infinitude de questions – elle nous entraîne en pensées le long de multiples sentiers qui bifurquent, de villes côtières englouties à Pripiat, où une nature viciée reprend le cours de son existence plusieurs décennies après la catastrophe de Tchernobyl ; de la vue en surplomb depuis la High Line new-yorkaise jusqu’aux bords de l’Elbe où, une nuit, le spectre d’une femme récemment disparue fait son apparition.
Le livre s’ouvre sur un Prélude et cette phrase de Virginia Woolf : « “Well, we must wait for the future to show”, said Mr Bankes, coming in from the terrace », suivie de toutes les versions venues à l’esprit de la traductrice, abandonnées ou conservées à mesure qu’elle sonde le texte comme pour y trouver son propre reflet, tenter d’en saisir l’essence bien que son labeur soit voué à l’imperfection, à l’inévitable « équivalence sans adéquation » ricœurdienne**. Qu’est-ce d’ailleurs que traduire, si ce n’est s’adonner à une tâche en pure perte, sans toutefois se départir de son absolue nécessité ? Qu’est-ce que traduire, si ce n’est se lancer corps et âme dans une traversée hasardeuse qui vous transforme pour toujours ?
« La traduction est une science inexacte, une tentative toujours non vouée à l’échec mais à l’imperfection. D’une langue à l’autre, la barque du passeur se heurte à des obstacles qu’elle affronte ou contourne, des vagues ou une simple houle, des courants contraires ou porteurs. C’est une traversée avec un point de départ et un point d’arrivée mais de l’un à l’autre une seule personne connaît le voyage et ses écueils, celle qui en a parcouru toutes les étapes. La traduction flotte dans un premier temps sans attache et peu à peu se rapproche de la base. La restitution du texte est en vue, elle dépend des contours, on distingue des formes plus précises et vient le moment où elle repose sur un socle solide, sur le sol ferme***. »
C’est par la voix, ou plutôt les mots de l’immense Virginia Woolf que la narratrice donne naissance à sa propre écriture ; une écriture telle une incidence, induite par l’envie et le besoin de raconter le travail de traduction, entre autres choses. Entre tout ce qui se produit à travers lui et au-delà, tout ce qui traverse l’existence de cette femme ayant fui à rebours. Entre les parenthèses de Woolf où gisent des morts comme par inadvertance.
Et c’est précisément à l’intérieur de ce texte qui l’occupe et l’obsède, où la lumière intermittente du phare le dispute à l’obscurité du monde, que surgissent les traces éparses d’une existence à jamais disparue – celle d’une autre femme écrivaine dont le nom nous est tu.
En traduisant et en se souvenant avoir confié à cette amie qu’elle ne se sentait pas écrivaine (ou du moins pas jusque-là), en choisissant de n’être que de passage dans une ville où elle n’avait aucun repère, où rien ne pouvait laisser présager d’y trouver ou retrouver le moindre indice de son passé, la narratrice tente de combler le vide qui la submerge depuis cette perte sans contour.
Elle réalise à quel point ce n’est pas un hasard que To the Lighthouse soit la première traduction qu’elle entreprend depuis la disparition de son amie. Et à l’instar des images ou objets qui peuplent une maison abandonnée à elle-même dans « Time Passes » (partie centrale et presque autonome de To the Lighthouse, publiée en édition bilingue par le Bruit du temps dans la toute première traduction de Charles Mauron en 1926), la narratrice n’a conservé de la disparue que des fragments de voix – cette voix que l’écriture ne pourra jamais fidèlement décrire, logée en celle qui l’a archivée pour continuer à en recevoir les échos impromptus.
« Dire que je dois partir.
Je ne comprends pas.
Qu’il faut me laisser.
Je ne comprends pas.
Ne plus penser à moi.
Pourquoi ?
Chaque pensée me ramène. Et j’ai besoin de m’éloigner, moi aussi, de m’installer dans un autre temps, un autre monde. »
Telle une plongeuse en apnée, Wajsbrot se laisse engloutir pour nous faire remonter à la surface du texte.
« Où siège la mémoire des voix ? »
En 2015, j’avais lu le très bel essai La Voix sombre de l’écrivaine et traductrice Ryoko Sekiguchi, livre qui m’accompagne depuis et dans lequel la lecture de Nevermore m’a donné une excellente occasion de me replonger.
Ryoko Sekiguchi écrit : « La pensée de la personne fait ressac, revient par à-coups. Comme cherchant à la retenir. Comme pour nous imposer de partager cette pensée, et ce faisant, lui imposer à son tour de rester de notre côté. »
Plus loin, « Voix et fantômes ont ceci en commun qu’ils troublent la temporalité. Les fantômes ne sont pas si “présents” que les voix, mais lorsqu’un fantôme apparaît, nous ne savons pas si c’est nous-mêmes qui sommes tirés vers le passé, ou si c’est le passé qui nous visite au présent. »
Cette visite du passé au présent est précisément ce à quoi la suspension volontaire de l’incrédulité permet de croire encore et toujours, sans cesse rejouée, ever more. Elle est aussi à l’origine de la dense superposition de strates qui composent Nevermore, succession d’« Interludes » que rien ne départit, écrits tandis que se traduit To the Lighthouse. En traduisant en écrivant, En écrivant en traduisant.
Et de ressac il est éminemment question : celui qui, dans son mouvement incessant, charrie le fantôme de l’amie disparue, sa voix, des souvenirs épars, les visages d’inconnues et inconnus croisés dans le café où la narratrice s’installe chaque matin, ses trouvailles sur Internet devenues notes, une philosophe partie nager dans un lac sans être jamais revenue, une ville de Floride disparue de Google Earth pendant un mois, la chambre spartiate à laquelle elle retourne chaque soir – mais cela n’aura qu’un temps.
Telle une plongeuse en apnée, elle se laisse engloutir pour nous faire remonter à la surface du texte qu’elle s’attelle à écrire tout en lisant et relisant une traduction qui, elle, se fait et se défait au fil des mouvements de pensée, et ne parviendra à quitter son état de flottaison, à s’arrimer à la terre ferme, qu’au moment où le livre qui l’enclot sera achevé.
Nevermore semble pourtant être voué à n’en plus finir, conçu dans sa structure même comme un éternel recommencement : les interludes se précèdent et se succèdent, le cœur et le corps du récit nichés à l’intérieur de ces espaces interstitiels agencés entre eux en une étrange partition. Au cours d’un concert où elle se rend seule pour écouter Les Hébrides de Mendelssohn (dont la composition fut inspirée par le ressac des vagues entendues depuis la grotte de Fingal), la narratrice éprouve des sensations qui la projettent dans un ailleurs où la réalité de l’instant n’a plus cours. Et tout en l’entraînant dans un lieu impossible à circonscrire, l’écoute fait aussi réapparaître l’amie disparue, assise juste à côté elle. Pourtant il n’y a personne.
« Je lui disais, lorsqu’un texte m’arrive, j’ai l’impression de voir débouler un animal sauvage. Il me fait peur, toute la difficulté, ensuite, est de l’apprivoiser. J’ai besoin de lire sans tarder, je laisse le reste en suspens pour me rassurer. Pour voir que, même s’il y a des difficultés, des problèmes importants, j’y arriverai. L’animal sauvage cesse alors de me menacer, après il faut le nourrir selon ses attentes, lui parler, être à son écoute. »
Cette vision du texte à traduire tel un animal sauvage m’a immédiatement remis en mémoire un fragment de lettre écrite à une date imprécise de 1949 ou 1950 par Marlene Dietrich, consultée il y a plus de dix ans à la JFK Library de Boston – sa correspondance avec Ernest Hemingway ayant été rendue publique peu de temps auparavant :
« …
my eye got so bad after reading about two hours – I had to stop.
…
Finished the manuscript just now. It is like a terrible animal lying quietly in your room and you don’t know when it will kill you. »
Les textes à traduire, à interpréter, ont donc cette force en eux qui surpasse l’espèce humaine. Ils mènent leur monde, à l’instar des animaux de Pripiat dont personne ne comprend l’ultime résistance, des phalènes de « Time Passes ». Les textes à écrire, eux, sont peut-être d’un autre ordre, tout aussi difficile à appréhender.
Et en revenant toujours à la source, To the Lighthouse, la maison de la lumière, le phare qui n’empêche pas les bateaux de se fracasser en mer, Nevermore nous fait sentir l’éminence du gouffre auquel est suspendu chaque écrivaine, chaque écrivain face à un texte qui, dès lors qu’il s’est écrit, ne lui appartient plus complètement. Ce gouffre où lectrices et lecteurs continueront de se jeter, encore et toujours.
Par Macelline Delbecq
Notes
*Dans Traduire ou perdre pied, Corinna Gepner décrit magnifiquement l’effet du travail de traduction sur la traductrice qu’elle est. Traduire ou perdre pied, éditions La Contre Allée, 2019
** Paul Ricœur, Sur la traduction, éditions Bayard, 2004
*** La semaine où j’ai lu Nevermore et écrit ce texte, l’émission Par les temps qui courent a consacré cinq émissions à des traductrices. Marie Richeux a lu cet extrait en introduction de l’épisode 4 sur l’écrivaine et traductrice du japonais Corinne Atlan le 11 mars 2021, dix ans exactement après la catastrophe de Fukushima.
